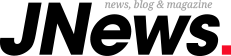L’Auberge de Tamazret est attachée à l’histoire personnelle de Patrick Bourseaux et de sa conjointe. Son parcours professionnel dans l’hôtellerie, à Tunis, Djerba puis à Ksar Ghilane, l’amène naturellement à Matmata. Il s’y attache, tant et si bien qu’il décide de s’y installer et part à la recherche d’une maison. En dépit d’en trouver une qui lui convienne à Matmata, il tombe sur la perle rare à Tamazret. Il s’agit d’un houch semi-troglodyte traditionnel, un vrai, de ceux qu’on ne fait plus. Patiemment, partie par partie, le houch, vétuste et dans un état de dégradation avancée à l’acquisition, sera soigneusement restauré et reprendra vie.
Il s’agit donc d’un houch organisé autour d’un patio, comme à l’accoutumée dans cette architecture vernaculaire du sud tunisien. Il était en bien mauvais état à l’achat en 2012, seuls les murs étaient encore debout.
La plupart des toits et plafonds étaient à remplacer. Il y avait bien une arrivée d’eau et d’électricité mais pas de distribution dans la maison. Sa configuration permettait d’aménager 4 chambres avec salles de bain, une cuisine avec sa réserve, un bureau, un salon, une salle à manger, une buanderie et des locaux de stockage sans avoir recours à des espaces supplémentaires. Ce qui constituait un avantage considérable dans la mesure où une extension était difficilement envisageable, l’acquisition de terrains étant quasiment impossible. Patrick Bourseaux pouvait non seulement y loger avec sa famille mais, également, y recevoir ses hôtes.
Le concept de maison d’hôte étant redondant, l’idée de l’auberge, formule très peu répandue en Tunisie, donnait une note de nouveauté attractive propice à aiguiser la curiosité du visiteur.
Patrick Bourseaux tenait à retrouver l’ambiance d’origine. Il a fallu trouver un architecte suffisamment sensible pour s’engager dans l’aventure. Le courant passa avec Mhedeb Abdelmoumen. Les travaux ont débuté en 2013 pour s’achever en 2014. L’exigence du maître de l’ouvrage à respecter l’esprit des lieux fut telle que pas moins de 18 maçons et entreprises de construction ont dû se relayer.
L’avantage d’avoir une structure porteuse solide a facilité la réactivation de l’ambiance initiale de la maison. Tout ce qui pouvait être sauvegardé en l’état l’a été, murs, plafonds, portes… La plupart des murs ont gardé la même apparence extérieure que la plupart des maisons non effondrées du village. Ils ont été grattés pour mettre en évidence les pierres anciennes. Seuls quelques enduits en ciment résistants ont dû être « camouflés » par des enduits de couleur sable.
Les grottes existantes, laissées dans leur état d’origine, ont été aménagées en salle à manger et chambres d’hôtes. Les tuyauteries électriques et sanitaires ont été soigneusement dissimulées dans les joints entre les pierres afin que leur vue ne nuise pas à l’apparence d’ensemble.
Aucune fenêtre supplémentaire n’a été rajoutée, en revanche les orifices existant ont été gardés dans les chambres. Ils assurent une aération parfaite bien meilleure dans ces maisons anciennes, qui datent de quelques centaines d’années, en comparaison avec celle des constructions modernes. Afin d’apporter un peu plus de lumière à certaines pièces, quelques briques de verre ont été placées dans les toits nouvellement construits.
Cette demeure est d’abord une résidence dans laquelle la famille loge durant toute l’année, elle est marquée par la personnalité de ses propriétaires. La plupart des objets sont issus d’héritages familiaux et chaque pièce a son histoire.
Au fur et à mesure, des objets de décoration, des tapis, des couvertures, des boiseries, des fers forgés, fabriqués par des artisans locaux, viennent enrichir la collection d’origine. Seuls les éléments sanitaires et électriques ont été achetés dans du- neuf, pour des raisons d’usage bien évidentes, pour autant ils ont été associés à des éléments locaux comme des supports de lavabos ou l’évier en pierre taillée par des artisans de Gabès.
Clairement ce houch renaît de ses cendres et retrouve une authenticité certaine, pour le bonheur de ses propriétaires et de ses hôtes qui ont l’opportunité d’y vivre une expérience inédite. Il fait la démonstration du potentiel de cette architecture vernaculaire, bien ancrée dans son environnement, en phase avec son climat, à s’adapter aux modes de vie contemporains et à répondre aux exigences de commodités modernes. Puisse ce projet servir de modèle à la pratique architecturale actuelle, qui, au nom d’un modernisme mal assimilé, ou tout simplement par ignorance, est bien trop pressée à détruire les traces d’un passé, le sien, considéré à tort comme désuet. Il est possible de renouveler la production architecturale locale, sans pour autant être réduit à la banaliser, à la lisser à l’image de ce qui se fait communément dans le reste du monde. Il est possible de raviver l’âme des lieux.
Texte : Alia Ben Ayed – Photos : Samia Chagour Françon
Article paru dans iddéco n°31 – Décembre 2016